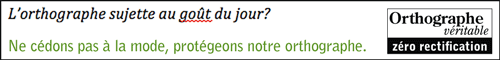L’écriture inclusive, entendue comme la volonté d’inclure tous les genres dans le discours écrit, est un sujet qui suscite beaucoup d’attention depuis plusieurs années. Si cette démarche part d’une intention louable — rendre la langue plus représentative —, elle ne doit pas se faire au détriment des règles fondamentales du français. Parmi les pratiques les plus contestées figure l’usage du point médian (ou point épicène), sous des formes variées : auteur·rice, étudiant/e/s, ami-e-s, etc.
Or, cette ponctuation importée et artificielle n’a aucune légitimité linguistique dans la grammaire française. Elle pose des problèmes typographiques, de lisibilité et d’accessibilité, et n’a jamais été reconnue par les instances de référence, telles que l’Académie française ou l’Office de la langue française.
Le typographe et le traducteur prendront soin d’utiliser les nombreuses méthodes existantes pour rendre un texte inclusif, et ce, sans utiliser des artifices mécaniques.
Proscrire la ponctuation épicène
Non-conformité grammaticale et typographique
Le point médian n’a pas de fonction grammaticale dans le français normé. Son emploi détourne un signe typographique de sa fonction première — séparer des éléments dans une abréviation ou une unité numérique — pour en faire un marqueur de genre. Il s’agit d’un emploi abusif et contraire à la logique syntaxique de la langue.
Illisibilité et rupture du flux de lecture
Les mots éclatés par des signes de ponctuation sont difficiles à lire, surtout pour les enfants, les apprenants étrangers ou les personnes dyslexiques. L’œil doit décoder plusieurs morphèmes au lieu d’un seul mot cohérent. Par exemple, étudiant·e·s se lit plus difficilement qu’étudiantes et étudiants, pourtant parfaitement inclusif et grammatical.
Problèmes d’accessibilité numérique
Les lecteurs d’écran utilisés par les personnes malvoyantes ne reconnaissent pas le point médian et épellent les mots un à un, rendant le texte incompréhensible. Cela contrevient à l’objectif d’inclusion, en excluant une partie du public pour des raisons techniques.
Absence de reconnaissance institutionnelle
Ni les textes de loi, ni les normes typographiques (comme celles de l’Imprimerie nationale), ni les grammaires officielles n’autorisent l’usage de ces ponctuations dites épicènes. Leur usage dans des documents administratifs ou officiels peut être considéré comme une faute.
Attention, certains groupes publierons leur propre guide, mais ce type de guide ne restera propre qu’au groupe l’ayant produit.
Perturbation de la cohérence linguistique
L’emploi de signes typographiques à la place de mots fragilise la structure même de la langue. Le français est une langue de précision et d’accords logiques, où chaque mot a sa place. Introduire des signes arbitraires brouille la syntaxe et déstabilise les lecteurs.
Difficulté de lecture à voix haute
L’un des grands principes de la langue française est sa musicalité. Or, la lecture à voix haute de mots éclatés par une ponctuation épicène rompt le rythme naturel de la phrase. Un mot tel que lecteur·rice ne peut être prononcé correctement, et force le lecteur à choisir une forme ou à marquer une pause artificielle. Cette rupture nuit à la fluidité, à la diction et à la compréhension du texte. On peut dire, en somme, que si une phrase ne peut être dite ou chantée naturellement, elle ne devrait pas être écrite. La langue française se pense et se parle à la fois ; tout écart entre l’écrit et l’oral affaiblit sa cohérence.
Altérations lors de la traduction ou de la transcription
Les mots déformés par une ponctuation épicène posent également des problèmes lors des passages d’un médium à un autre : du français vers l’anglais, ou de l’écrit vers l’oral, puis à nouveau vers l’écrit. Les logiciels de traduction, les outils de synthèse vocale et même les traducteurs humains ne savent comment interpréter ces symboles.
Ainsi, étudiant·e·s devient souvent un terme erroné, tronqué ou altéré lors d’une traduction automatique, ce qui dénature le sens initial du texte. De même, une transcription d’un discours lu ne saurait reproduire une ponctuation qui n’a pas de correspondance orale. Ces passages révèlent l’inadéquation de la ponctuation épicène avec les usages naturels de la langue.
Une cohérence linguistique à préserver
L’écriture doit demeurer compatible avec la lecture, la parole, la traduction et la mémoire. Le point épicène, en rompant ces liens essentiels, fragilise la transmission même du français. Respecter les règles de lisibilité, de prononciation et de cohérence, c’est préserver la vitalité de la langue.
Les alternatives conformes et élégantes
Plutôt que de déformer les mots avec des points ou des tirets, la répétition complète constitue une solution claire, correcte et lisible :
- Préférer : « les autrices et les auteurs »
- Éviter : « les auteur·rice·s »
Cette forme a l’avantage d’être grammaticalement juste, lisible par tous, et conforme à la typographie française traditionnelle. Lorsque l’espace est restreint (titres, tableaux, affiches, formulaires), une seule concession est tolérable : l’usage des parenthèses, qui existent déjà dans notre système d’écriture et respectent sa cohérence visuelle et grammaticale. Ainsi, on écrira :
- « auteur(trice) »
- « employé(e) »
- « lecteur(trice)s »
Les parenthèses n’introduisent ni ambiguïté syntaxique ni rupture de lecture. Elles restent un signe de ponctuation traditionnellement admis.
Une langue déjà riche et inclusive
La langue française offre, depuis des siècles, de multiples procédés pour exprimer la mixité ou la neutralité : périphrases, doublets complets, tournures génériques ou neutres. Elle n’a nul besoin d’artifices typographiques pour être inclusive. Plutôt que d’imposer des symboles étrangers à sa structure, mieux vaut recourir à sa richesse lexicale et grammaticale :
-
Le corps enseignant au lieu de les enseignant·e·s
Le personnel administratif plutôt que les administrateur·rice·s
Les membres du conseil au lieu de les conseiller·ère·s
Ces tournures respectent la clarté, la fluidité et l’élégance du français tout en incluant chaque individu sans distinction de genre.